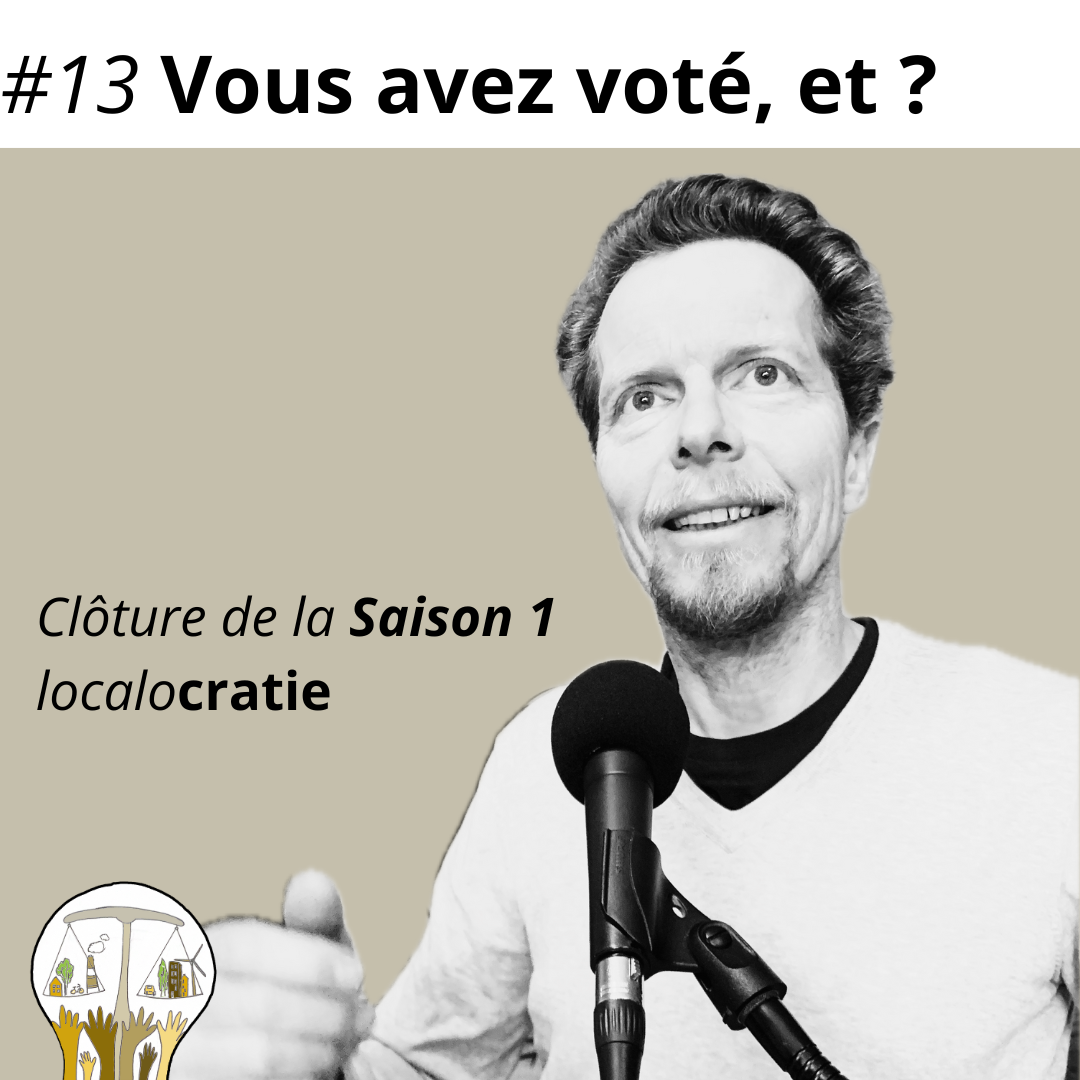La saison 1 de Localocratie a été finalisée quelque peu “tambour battant » pour clôturer les dernières interviews trois mois avant les élections communales du 13 octobre, et ainsi respecter la période de prudence, surtout que j’étais moi aussi candidat.
Cette première saison a eu pour objectif de mettre en évidence quelques-uns des grands rôles, des grandes fonctions qui encadrent la démocratie locale. Et donc l’organisation d’une Commune. Car les rôles politiques sont en train d’être réattribués suite aux élections. Petite synthèse explicative de ce qui s’est donc déroulé dans chaque commune depuis le dimanche 13 octobre.
Le dépouillement des votes s’est opéré en deux temps. D’abord, on comptabilise pour chaque liste le nombre de voix reçues. Peu importe si l’électrice ou l’électeur a coché la case de tête ou trois noms sur la liste, cela rapporte une voix à la liste. Lorsque tous les votes ont été répartis, et en faisant abstraction des votes blancs ou nuls, on octroie à chaque liste un certain nombre de sièges.
On entend souvent des critiques sur le système américain des « grands électeurs », mais chez nous aussi les sièges communaux ne sont pas attribués de manière proportionnelle, i.e. au pourcentage de votes reçus, mais en fonction d’une clé de répartition, la clé Imperiali. Décidée en 1921, celle-ci attribue plus de sièges aux listes qui font les plus gros scores. Le législateur de l’époque souhaitait assurer des majorités stables, en donnant plus de poids aux « vainqueurs ». A la fin de cette étape, on sait donc combien de sièges vont à chaque liste qui s’est présentée aux élections.
Le nombre de sièges dans chaque commune dépend de la taille de la population locale. Prenons l’exemple d’une commune de 8.000 habitants où il faut attribuer 19 sièges. Trois listes sont en présence : la liste A avec 47% des votes, B avec 33% et C avec 20%. La clé Imperiali résulte en 10 sièges pour la liste A : elle empoche la majorité absolue des sièges. La liste B reçoit 6 sièges et la liste C seulement 3 puisque, en tant que plus petite liste, c’est elle qui a « donné » un siège à la plus grosse.
Ensuite, étape 2, on trie au sein de chaque liste les candidat·es par ordre de qui a reçu le plus de voix individuelles. Depuis 2018, la case de tête n’intervient plus et seuls comptent les votes à côté du nom de chaque candidat·e. Un point chaque fois que la case a été cochée en rouge à côté du nom. Si la liste a remporté 6 sièges, les 6 personnes de cette liste ayant reçu le plus de voix sont élues. Et si quelqu’un se désiste, que ce soit de suite ou plus tard dans la législature, est alors élue le 7ème personne et ainsi de suite. Fin du processus électoral, communiqué dès le soir-même des élections, début des négociations politiques.
Car il s’agit maintenant d’établir une majorité communale, c’est-à-dire un groupe d’une ou plusieurs listes disposant de plus de la moitié des sièges au Conseil communal, et donc à même de faire avancer ses décisions. Et dans ce groupe sont désignés les bourgmestre, échevines et échevins. Ceux-ci seront rémunérés par la commune tandis que tous les autres conseillers perçoivent uniquement un jeton de présence, de l’ordre de 100 euros bruts par conseil communal.
Si une seule liste n’obtient pas la majorité absolue, il s’agira d’une alliance de deux ou plusieurs listes. Un pacte de majorité est établi et publié le 12 novembre. Se dessinent alors au Conseil deux bancs avec d’une part les conseillers de majorité, d’autre part ceux de minorité – ou opposition.
Au sein de la majorité, la ou le bourgmestre est désigné·e par la loi comme la personne avec le plus de voix sur la liste la plus grosse de celles qui composent la majorité. Dans notre exemple, la liste A signant seule le pacte de majorité, c’est la personne avec le plus de voix de la liste A qui est bourgmestre. Si cette personne refuse d’être bourgmestre, et était dans les trois premières places de la liste sur le bulletin électoral, elle ne peut pas devenir échevine. On demande alors au 2ème meilleur score. Ce système de désignation n’existe pas à Bruxelles mais est aussi utilisé en Flandres (ou de plus la liste la plus grosse a la priorité pendant 14 jours pour négocier une majorité).
Pour les échevin·es, il n’y a pas de règles : c’est aux parties en présence de les désigner dans le pacte de majorité avec totale liberté de répartition entre les listes, mais en veillant à « un tiers minimum des membres de chaque sexe ». La loi fixe aussi le nombre de postes scabinaux en fonction de la taille de la population. Pour l’exemple de notre commune de 8000 habitants, il s’agira de 4 échevin·es.
Avec en plus la présidence du CPAS, sur lequel on va revenir, voici alors le Collège communal qui est formé. C’est lui qui, en tandem avec l’administration communale qui n’a pas changé pendant les élections, va diriger la commune pour les 6 prochaines années. Avec toujours un jeu de double signature : la ou le bourgmestre pour l’engagement politique, le ou la Directrice générale pour l’engagement légal. Et la ou le Directeur financier qui avalise toute dépense. Derrière ces trois rôles-phares, c’est toute une administration de plusieurs dizaines, voire centaines, de personnes qui réalisent les projets au quotidien.
Du côté du CPAS, le Centre Public d’Action Sociale, les mécanismes sont relativement similaires, mais indirects. En fonction du nombre de sièges obtenus au Conseil communal, chaque liste obtient un certain nombre de sièges au Conseil de l’Action sociale, qui sera donc dirigé par la même majorité que la Commune. Et la personne qui occupe la présidence du CPAS fait partie du Collège communal et est rémunérée au même titre qu’un·e échevin·e. Petite particularité pour les conseiller·es de l’action sociale désigné·es par chaque liste : il ne peut y avoir plus d’un tiers de conseillers communaux. On y retrouve donc souvent des personnes candidates mais non élues, et des citoyen·nes intéressé·es par les thématiques sociales.
Et moi, qu’ai-je retenu de cette première saison, qui était à la fois mon premier essai dans cet exercice et l’occasion d’en apprendre plus sur ces sujets qui me passionnent ? Tout d’abord, il a fallu choisir des personnes, et ce n’est pas simple. Car je tenais à respecter plusieurs équilibres : femme-homme bien entendu, mais aussi des communes de tailles et de contextes différents (urbain-rural, provinces différentes…) sans oublier évidemment les couleurs politiques. Ce fut sans doute le point le plus difficile car il dépendait aussi de qui acceptait ou non mes invitations. Au final, j’aurai réussi à amener au micro des gens membres ou proches des 4 partis traditionnels de Wallonie, et également une approche citoyenne. Il faudra qu’un jour je complète avec le PTB.
Et de chaque rencontre, qu’est-ce que je retiens ?
L’exercice n’était pas évident car l’objectif du podcast est de mettre en avant une opinion, celle de la personne que j’interviewe, et pas la mienne.
Du côté politique, il n’a pas été facile de trouver un ou une bourgmestre acceptant de répondre à un podcast citoyen. Et bien que je ne trouve personnellement pas idéal que quelqu’un reste aussi longtemps au pouvoir, c’est Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne, qui a accepté. Bourgmestre wallon le plus longtemps en fonction, je pense néanmoins qu’il a des choses à nous apprendre. Ceci dit, il ne m’a pas surpris par l’importance qu’il accorde aux relations d’amitié ou d’inimitié entre personnes, lui dont on sait qu’il est souvent très (trop, reconnaît-il presque entre deux phrases) tranchant avec ses opposants. Il m’a donné envie de creuser plus tard le sujet, compliqué, de la fusion des communes car il s’y oppose aujourd’hui tout en reconnaissant tout le positif que la fusion de 1977 a apporté à sa commune.
Stéphanie Scailquin, échevine à Namur, est d’une franchise incroyable lorsqu’elle explique comment se forme un Collège communal et la manière dont leur groupe fonctionne derrière le chef-bourgmestre. Elle illustre très bien aussi le nombre de sujets différents sur laquelle la population attend qu’une échevine sache apporter des réponses.
Saba Parsa , conseillère à Rhode-Saint-Genèse, m’a fait voir autrement le rôle finalement très discret et humble de ces conseillères et conseillers de majorité qui sont en contact avec la population. Mais qui, n’étant pas eux-mêmes aux manettes, servent surtout de relais vers le Collège communal.
Olivier Vanham, conseiller à Braine-l’Alleud, touche à un des enjeux de notre système démocratique : pas de véritable démocratie sans contre-pouvoir, notamment avec une opposition qui scrute et questionne. Mais son témoignage montre aussi les limites d’un système où la majorité ne tend pas la main à la minorité pour réfléchir ensemble aux enjeux-clés d’une commune.
Maurane Hogne, conseillère dite « citoyenne » à Frameries, nous offrait un vent de fraicheur en montrant que des citoyen·nes s’engagent de manière non partisane, sans s’affilier à aucun parti. Car ils ou elles rêvent d’améliorer le vivre ensemble de leur commune.
Isabelle Groessens, présidente de CPAS, nous a fait découvrir certains aspects de cette institution, et au passage de tout service public, notamment en montrant le temps qu’il faut pour mettre en place un « petit » changement logistique dont l’impact est potentiellement très grand sur la vie des gens. Son exemple des buffets-repas en maison de retraite est une très belle illustration de l’impact positif que les institutions peuvent apporter.
Du côté de l’administration, je n’ai eu l’occasion de ne rencontrer que trois personnes, et d’autres viendront dans les prochaines saisons tant le personnel de nos administrations communales est rarement reconnu à sa juste valeur. Charles Havard, directeur général de la commune de Visé, Martine Rademacker, directrice financière de la commune d’Oupeye, et Mélanie Lazzari, directrice générale du CPAS de Hannut, partagent tous les trois une même passion pour le service public et le travail bien fait. En discutant avec eux, je me suis surtout rendu compte de ce que, ne trouvant pas de meilleure clé pour faire confiance et déléguer, notre démocratie crée une surcouche de procédures qui rend la vie de ces personnes, et de toutes leurs administrations, non seulement compliquée mais aussi fastidieuse à force de documentation qui prend le dessus sur le résultat concret. Autre sujet sur lequel il faudra revenir !
Les points de vue externes amenés par des observateurs de la vie communale ont également été riches en enseignements : les réflexions d’Arnaud Ruyssen sur la démocratie directe ne m’ont pas quitté et ont alimenté la préparation de la saison 2 ; la mise en lumière de la vie locale au regard des droits humains de Laurent Deutsch soulève aussi de nombreuses questions sur les enjeux, et finalement la raison d’être, de notre système démocratique ; et les études de Tom Verhelst sur le ressenti des élu·es m’a surpris de par l’ampleur des critiques de celles et ceux qui font vivre la démocratie locale mais estiment qu’elle mériterait encore des améliorations.
Ce fut un plaisir de réaliser cette première saison de Localocratie en mettant en évidence tous ces rôles et ces points de vue, avec chaque fois de belles rencontres à la clé.
Quant aux citoyen·nes, ils ne reviendront voter que dans 6 ans. Mais leur rôle ne s’arrête pas à ce seul vote : il y a de nombreuses manières de s’impliquer et d’influer sur la vie communale, des commissions instituées par la Commune à d’autres mécanismes. Ce sera le thème de la saison 2 de Localocratie qui démarrera en janvier 2025.
Notes et références
- Définition et présentation du fonctionnement de la clé Impériali dans le lexique wallon pour les élections du 13 octobre 2024. Un citoyen en a fait un simulateur accessible au grand public.
- Article de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) sur la composition d’un conseil communal.
- Présentation, toujours par l’UVCW, du formalisme du pacte de majorité et de la composition d’un Collège communal.
Dites-moi ce que vous en pensez
Si ce contenu vous a plu, prenez 30 secondes pour me le dire en me laissant un commentaire ou quelques pouces ou étoiles sur votre plateforme de podcasts préférée. Partagez-le également autour de vous auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Mille mercis ! Et c’est aussi une manière de stimuler la démocratie.
Si vous avez des idées, des commentaires ou des critiques, n’hésitez surtout pas à me le faire savoir ! Je suis présent sur les réseaux sociaux, les liens sont dans le pied de page ci-dessous.